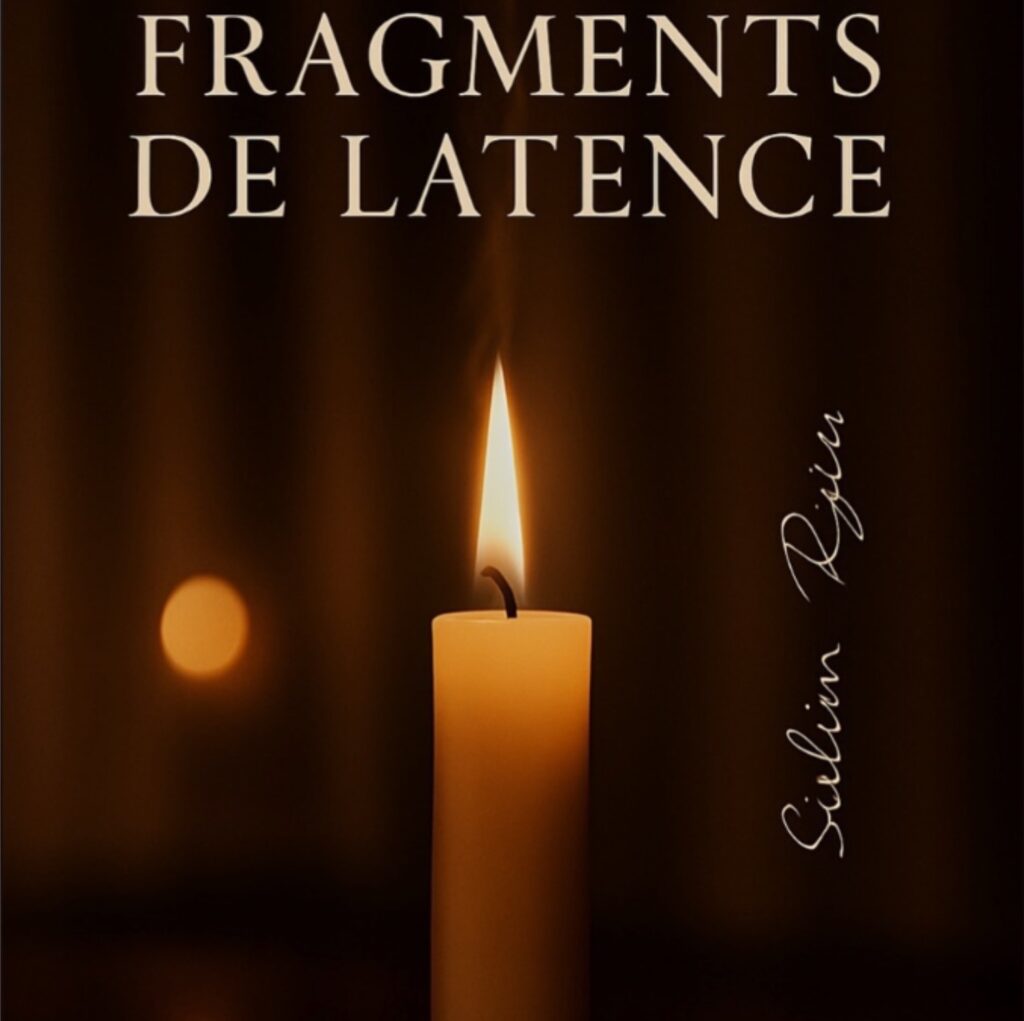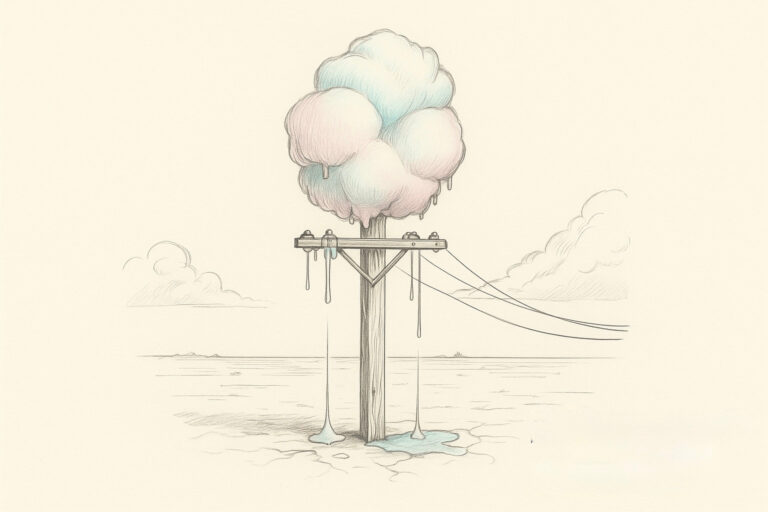- Salim Rzin
Le Moi-Porcelaine
Dans une maison victorienne, vers 1896, le silence n’était pas un calme, mais une tension.
Tout en haut de l’étagère, là où l’air semblait plus rare, résidait Anna. Elle n’était pas un jouet ; elle était un verdict. Margaret passait des heures à la fixer d’en bas, les mains croisées avec application, attendant l’instant où un adulte consentirait à rompre la distance entre le sujet et l’idole.
Lorsque Anna descendait enfin, le monde de Margaret se contractait jusqu’à l’atome. Elle ne jouait pas ; elle entrait en dévotion. Son corps se déplaçait de quelques centimètres, à gauche, puis à droite, le souffle suspendu, pour vérifier si les globes de verre d’Anna allaient enfin la retenir, l’inscrire dans l’existence. Elle cherchait son reflet dans cette pupille figée, comme si être vue par Anna pouvait l’autoriser à être là. Le regard de l’objet devenait le seul lieu possible d’une reconnaissance.
Mais cette grâce était toujours contaminée par l’angoisse du détail. Margaret était hantée par l’anarchie de la matière. Un fil qui dépassait d’une couture prenait valeur de cri intérieur. Une brindille de paille, dressée hors du chapeau d’Anna, suffisait à faire vaciller l’ensemble de sa sécurité. Ce n’était pas la poupée qui se dégradait ; c’était son être même qui risquait de s’effondrer. Dans cette imperfection, elle lisait la menace, le procès d’une identité fixée une fois pour toutes : celle de l’enfant immature, débordante, coupable d’exister trop.
Alors elle ne coiffait pas Anna, elle la rectifiait. Elle ne jouait pas, elle réparait à l’avance. Terrifiée par l’idée qu’une seule tache sur la soie ne transforme un jugement en condamnation, elle avait appris à contenir toute excitation, toute agressivité ludique. Très tôt, elle avait intégré cette loi muette : préserver l’objet avant de s’autoriser à exister.
C’est ainsi que son Moi avait trouvé une issue paradoxale. Plutôt que de risquer un monde vécu comme fragile, il s’était adossé à un Surmoi précoce, utilitaire, chargé de maintenir l’ordre et la cohérence.
Margaret n’était pas une enfant qui jouait ; elle était devenue la gardienne du sanctuaire.
Puis la métamorphose injuste arriva avec Mary.
Mary ne gardait rien. Elle salissait, tordait, cassait. Et pourtant, elle ne se brisait jamais en retour. Margaret observait, pétrifiée, cette liberté sans sanction. Mary avait le droit de dégrader sans peser lourd. Son statut de sujet survivait aux décombres de ses jeux. Là où Margaret avait appris que l’objet ne devait pas être touché, Mary découvrait que le monde tenait malgré l’usage.
Ce n’était pas une simple jalousie. C’était une rupture logique. L’objet pouvait survivre à la destruction, mais pas chez la même enfant.
Dans un mutisme douloureux, Margaret ramassait compulsivement les membres épars, les corps de chiffon vidés, ces restes abandonnés après le passage de Mary. Elle contemplait le panier à jouets comme on regarde une fosse commune de ses propres possibles. Une poubelle de souvenirs, non pas de ce qui avait été perdu, mais de ce à quoi elle n’avait jamais eu droit. En réparant les ruines des autres, elle tentait une dernière fois de sauver un monde interne déjà sacrifié.
C’est là que quelque chose s’est figé. Son Moi, incapable de se tenir seul, s’est définitivement confondu avec la fonction de réparation. Elle ne serait jamais celle qui habite le jeu, mais celle qui nettoie après coup. Non par masochisme, mais par fidélité à une loi ancienne : exister sans laisser de trace.
Certains adultes arrivent plus tard en analyse avec cette même architecture. Ils sont fiables, investis, productifs. Ils savent soutenir, contenir, réparer. Mais dès qu’il s’agit d’habiter une place pleine, quelque chose se retire. Ils n’attaquent pas l’objet ; ils le protègent. Ils n’osent pas l’utiliser ; ils craignent d’en être la cause de chute. Tant que le monde doit être préservé, il ne peut pas être habité.
Advenir comme sujet, pour eux, ne consiste pas à devenir destructeur. Il s’agit de risquer un geste, un déplacement, une trace, faire l’éxperience que l’objet survit.
Il faut parfois une vie entière pour comprendre que le monde ne se retire pas quand on y entre.
- •

Publications similaires
J’ai récemment lu Je suis un monstre qui vous parle de Paul B. Preciado. Une claque. Une secousse. Ce texte m’a retourné, dérangé, embarrassé aussi. J’imaginais la scène : lui, seul au…
Le soin ne rassasie pas, il apprend à attendre. Satiété symbolique Un jour, un psychanalyste m’a fermé la porte de son cabinet en me disant : « Ici, ce n’est…
L’illusion du lien sucré Il y a des époques qui se racontent à travers un objet, une image, un goût. La nôtre pourrait bien se résumer à une barbe à…
J’ai récemment lu Je suis un monstre qui vous parle de Paul B. Preciado. Une claque. Une secousse. Ce texte m’a retourné, dérangé, embarrassé aussi. J’imaginais la scène : lui, seul au…
Le soin ne rassasie pas, il apprend à attendre. Satiété symbolique Un jour, un psychanalyste m’a fermé la porte de son cabinet en me disant : « Ici, ce n’est…
L’illusion du lien sucré Il y a des époques qui se racontent à travers un objet, une image, un goût. La nôtre pourrait bien se résumer à une barbe à…
I. Les marathons : rituels collectifs On raconte souvent que notre époque a perdu ses rituels, sa religiosité mais est assoiffée de spiritualité. Je ne sais pas si c’est vrai. Ce que…